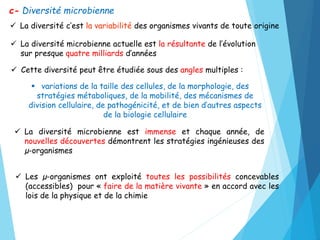
Cours Microbio
- 1. c- Diversité microbienne La diversité c’est la variabilité des organismes vivants de toute origine La diversité microbienne actuelle est la résultante de l’évolution sur presque quatre milliards d’années Cette diversité peut être étudiée sous des angles multiples : variations de la taille des cellules, de la morphologie, des stratégies métaboliques, de la mobilité, des mécanismes de division cellulaire, de pathogénicité, et de bien d’autres aspects de la biologie cellulaire La diversité microbienne est immense et chaque année, de nouvelles découvertes démontrent les stratégies ingénieuses des µ-organismes Les µ-organismes ont exploité toutes les possibilités concevables (accessibles) pour « faire de la matière vivante » en accord avec les lois de la physique et de la chimie
- 2. Cette diversification permet de placer la diversité de la physiologie des µ-organismes parmi les plus remarquables La diversité de la physiologie Toutes les cellules ont besoin de produire de l’énergie et de la conserver Les sources d’énergie sont d’une importance primordiale pour les cellules, car les processus vitaux consomment beaucoup d’énergie Trois stratégies s’offrent pour puiser l’énergie de la nature à partir : des composés organiques, des composés inorganiques ou de la lumière (schéma) Cette importante capacité métabolique a rendu possible la colonisation de nombreux habitats par les µ-organismes, stimulant ainsi leur évolution et leur diversification
- 3. Les chimio-organotrophes - Utilisation composés organiques Les chimio-lithotrophes - Utilisation composés inorganiques Les phototrophes - Les µ-organismes phototrophes possèdent un pigment - Deux types de phototrophies: photosynthèse oxygénique, et photosynthèse anoxygénique Les hétérotrophes source de carbone des composés organiques Concernant les sources de carbone 2 possibilités s’offrent: Les autotrophes source de carbone est le CO2 Les procaryotes habitant les environnements extrêmes sont appelés extrémophiles qui sont abondants dans des environnements où certains organismes plus évolués ne pourraient pas survivre
- 4. La diversité des procaryotes Les analyses d’ARN ribosomiques extraits d’échantillons environnementaux ont révélé de nombreux groupes phylogénétiques distincts (25 phylums) Plusieurs groupes phylogénétiques sont présents dans les domaines des Archaea et des Bacteria, ainsi qu’une grande diversité de morphologies cellulaires et de physiologies
- 5. 1- Le domaine des Bacteria Le domaine des Bacteria est extrêmement diversifié, comportant tous les procaryotes pathogènes connus à ce jour, ainsi que des centaines d’autres espèces non pathogènes La dimension de chaque rectangle de couleur est proportionnelle au nombre relatif de genres et d’espèces connus par groupes Arbre phylogénétique des Bacteria Ph11 Ph10 Ph9 Ph8 Ph7 Ph6 Ph5 Ph4 Ph1 Ph2 Ph3
- 6. 1- Les protéobactéries représentent le phylum le plus important des bactéries Chez les protéobactéries se retrouvent un grand nombre de chimio- organotrophes, tel qu’Escherichia coli, organisme modèle en physiologie, biochimie et biologie moléculaire Plusieurs phototrophes et chimiolithotrophes sont aussi des protéobactéries De nombreux autres procaryotes communs du sol, de l’eau, des plantes, des animaux, ainsi que des espèces pathogènes (Salmonella, Rickettsia, Neisseria et bien d’autres encore), sont des protéobactéries 2- Les Gram+, phylum se distinguant par une parenté phylogénétique et des propriétés de parois communes On retrouve ainsi Bacillus, une bactérie formant des endospores, Chlostridium, et d’autres bactéries sporulantes telles que Streptomyces, capable de produire des antibiotiques On trouve également des bactéries lactiques telles que Lactobacillus et Streptococcus qui sont fréquemment identifiées dans les produits laitiers, les plantes et la matière en décomposition
- 7. Les mycoplasmes sont aussi apparentés aux Gram+: ces procaryotes n’ont pas de paroi cellulaire et contiennent de très petits génomes 3- Les cyanobactéries, phylum regroupe les phototrophes oxygéniques qui sont phylogénétiquement apparentées aux bactéries Gram+ Elles ont joué un rôle crucial dans l’évolution de la vie sur la Terre, pour avoir été les premiers phototrophes oxygéniques 4- le phylum aquatique des Planctomyces, qui se caractérisent par des cellules comportant un pédoncule leur permettant de se fixer à un substrat solide 5- Les spirochètes, bactéries de forme hélicoïdale responsables de nombreuses maladies, notamment la syphilis et la maladie de Lyme
- 8. -6-7- Deux autres phylums de Bacteria sont phototrophes : les bactéries vertes sulfureuses (groupe des Chlorobium) et les bactéries vertes non sulfureuses filamenteux (groupe des Chloroflexus) Ces espèces contiennent toutes deux des pigments photosynthétiques similaires et sont capables d’autotrophie 8- Un autre phylum majeur de bactéries, Deinococcus est composé de bactéries présentant des parois cellulaires inhabituelles et qui sont capables de résister à des taux d’irradiation importants, Deinococcus radiodurans étant la principale espèce de ce groupe 9-10-11 Enfin, quelques groupes des Bacteria divergent à la base de l’arbre universel du vivant: Thermotoga, Env-OP2 et Aquifex Malgré le fait qu’ils soient phylogénétiquement distincts, ces groupes ont la capacité de croître à des températures élevées (hyperthermophilie) Ainsi, des organismes tels que Aquifex et Thermotoga sont capables de se développer dans de l’eau proche de son point d’ébullition (sources hydrothermales)
- 9. 2- Le domaine des Archaea Toutes les Archaea sont chimiotrophes et la plupart sont chimiolithotrophes, leur principale source d’énergie étant l’hydrogène (H2) Le domaine des Archaea se divise en deux phyla : les Euryarchaeota et les Crenarchaeota sur la base de la séquence de leurs ARNr Le phylum des Crenarchaeota contient des organismes thermophiles et hyperthermophiles qui métabolisent le soufre Le second phylum, les Euryarchaeota comprend essentiellement les procaryotes méthanogènes et les procaryotes halophiles Les deux phylums sont subdivisés en 8 classes et 2 ordres
- 10. les groupes phylogénétiques positionnés à la base de la branche du domaine des Eukarya sont des eucaryotes de structure simple, dépourvus de mitochondries et d’autres organelles majeurs La diversité microbienne des eucaryotes Il existe une très grande diversité des µ-organismes eucaryotes, La plupart de ces eucaryotes positionnés à la base de l’arbre du vivant sont des parasites de l’homme et d’animaux, ils sont incapables de survivre indépendamment ces µ-organismes sont communément appelés protistes
- 11. Certains d’entre eux, tels que les algues sont phototrophes ces algues contiennent des organites riches en chlorophylle appelés chloroplastes Les mycètes sont soit unicellulaires (levure), soit filamenteux (moisissures), et ne possèdent pas de pigments photosynthétiques Ces champignons sont d’ailleurs les principaux agents de biodégradation de la nature et recyclent la majorité de la matière organique des sols et d’autres écosystèmes. Différents protozoaires sont répartis sur l’arbre des Eukarya Ainsi, certaines espèces telles que les flagellés se retrouvent à la base de l’arbre, alors que d’autres espèces ciliées, se retrouvent dans les branches supérieures
- 12. d- Taxonomie microbienne 2 mots grec: Taxis = arrangement ou mise en ordre Nomos = loi La taxonomie ou la taxinomie Les organismes vivants sont étonnamment divers: Selon leurs ressemblances mutuelles arranger les organismes vivants en groupes + Façon hiérarchique (échelonnée) et sans chevauchement Nécessité de les classifier La taxonomie = Systématique: la science de la classification biologique La taxonomie microbienne est en effervescence ces temps-ci à cause de l’emploi des nouvelles techniques moléculaires Les approches classiques gardent quand même leur valeur et sont également toujours évoquées
- 13. Classification, Nomenclature, Identification Arrangement en groupes selon la similitude ou la parenté évolutive * * Ces groupes ( niveau hiérarchique quelconque) Classification Taxons Nomenclature Noms aux groupes taxonomiques selon des règles publiées Vocabulaire universel Côté pratique de la taxonomie * * Détermination de l’appartenance à un taxon Identification Caractéristiques phénotypiques et moléculaires Au sens large, la taxonomie est faite de 3 branches distinctes, mais reliées entre elles:
- 14. Les Rangs taxonomiques ou Les échelons hiérarchiques En préparant une classification, on place le µ-organisme à l’intérieur d’un petit groupe homogène qui est lui-même membre d’un groupe plus large dans une organisation hiérarchique et non chevauchante Dans la taxonomie des procaryotes, les niveaux ou les rangs taxonomiques les plus utilisés sont par ordre descendant: Domaine- Règne – Phylum (embranchement) – Classe - Ordre – Famille – Genre - Espèce A chaque niveau ou rang, les groupes microbiens ont des noms avec des terminaisons ou des suffixes caractéristiques de ce niveau Tableau 1 : Rang taxonomique d’E. coli. RANG EXEMPLE Domaine Règne Phylum Classe Ordre Famille Genre Espèce Procaryote Bactéria Proteobacéria Gamma Proteobacéria Enterobactériales Enterobactériaceae Escherichia Escherichia coli Exemple d’un rang taxonomique d’un colibacille bien connu : E. coli
- 15. Les microbiologistes nomment les micro-organismes en utilisant le système binomial du biologiste suédois Linné Nom latin en italique comprend deux parties: Nom générique (du genre) L’épithète spécifique (débutant par une majuscule ) (en minuscule) Exp: Escherichia coli L'unité taxonomique = l'espèce L’espèce est l’unité de classification ou taxon de base en taxonomie des êtres vivants Une espèce biologique est un ensemble d'individus qui présentent un haut degré de ressemblance phénotypique Chez les organismes supérieurs, la notion d'espèce est fondée sur l'interfécondité des individus: patrimoine héréditaire
- 16. Cette définition ne convient plus aux membres µ-organismes qui ne se reproduisent pas de façon sexée (haploïdes, voie asexuée) En plus, les espèces procaryotes sont caractérisées par des différences phénotypiques et génotypiques Une espèce procaryote: un ensemble de souches qui partagent de nombreuses propriétés stables et différentes de façon significative des autres groupes de souches Cette définition est très subjective et peut être interpréter de beaucoup de façons Une autre définition plus précise a été proposée par des taxonomistes bactériens: Une espèce procaryote est un ensemble de souches qui ont une teneur en GC similaire et une similarité de 70% ou plus estimée par des expériences d’hybridation de l’ADN
- 17. N.B: des « significations » à l’intérieur de la définition d’espèce sont aussi utilisées: Une souche est une population d’organismes qui se distingue d’autres populations à l’intérieur d’une catégorie taxinomique On considère qu’elle provient d’un organisme unique ou d’un isolat de culture pure, les individus d'une souche sont en principe identiques sauf en cas de mutation Les souches à l’intérieur d’une espèce peuvent différer légèrement l’une de l’autre de multiples façons: * Des biovars: souches variantes caractérisées par des différences biochimiques ou physiologiques * Les morphovars: différent morphologiquement * Les sérovars: ont des propriétés antigéniques distincts Une souche type c’est habituellement une des premières souches étudiées, elle est souvent plus complètement caractérisée que les autres souches (membre représentatif)
- 18. Les systèmes de classification * Classification phénétique ou phénotypique: groupe les organismes suivant la similitude de leur caractères phénotypiques Tests morphologiques, biochimiques, physiologiques * Classification numérique: approche quantitative devenue possible grâce à l’avènement des ordinateurs, permet le groupement taxonomique à l’aide des méthodes numériques Le procédé de cette classification débute par la détermination de la présence ou de l’absence de caractère sélectionné dans le groupe d’organismes étudié Au moins 50 caractères et de préférence plusieurs centaine Inclure nombreux types de données différentes: morphologiques, biochimiques… Les résultats de l’analyse taxonomique numérique sont souvent résumés en arbre appelé Phénogramme Les caractéristiques d’intérêt taxinomiques les plus employées sont la morphologie, la nutrition et la physiologie, ainsi que l’habitat Dendrogramme construit par les caractères phénotypiques
- 19. Rch 9869 Rch 9868 Rch 9871 Rch 9813 Rch 9835 Rch 9832 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 Rch 982 Rch 983 Rch 988 Rch 989 Rch 9821 Rch 9822 Rch 9840 Rch 9841 Rch 9842 Rch 7 Rch 128 Rch 102 Rch 8 Rch 9815 Rch 9816 Rch 10 Rch 28 Rch 35 Rch 18 Rch 30 Rch 2 Rch 5 Rch 14 Rch 16 Rch 161 Rch 134 Rch 94 Rch 60 Rch 19 Rch 24 Rch 13 Rch 984 Rch 985 Rch 9819 Rch 9820 Rch 9861 Rch 9862 Rch 9863 Rch 9865 Rch 125 Rch 126 Rch 981 Niveau de similarité Phénogramme représentant la similarité phénotypique entre les rhizobia du pois chiche isolés des différentes régions du Maroc.
- 20. * La Taxonomie moléculaires utilise les nouvelles techniques moléculaires qui concernent l’étude des protéines et des acides nucléiques (ADN et ARN) * La Taxonomie phylogénique ou phylétique: il s’agit de systèmes basés sur des relations évolutives plutôt que sur une ressemblance générale Ceci s’est avéré difficile dans le cas des bactérie (manque de fossiles), cependant la comparaison des ARNr a permis de surmonter certains de ces problèmes * La Taxonomie polyphasique: il s’agit des systèmes taxonomiques qui utilisent une large gamme d’informations phénotypiques, génotypiques et phylogénétiques La plus utilisée actuellement
- 21. - Biology of microorganisms M.T. Madigan and J.M Martinko Eighth Edition, 1997 Brock - MICROBIOLOGIE L. PRESCOTT, J. HARLEY, D. KLEIN 2e édition, 2002 - Biologie des micro-organismes M. Madigan et J. Martinko 11e édition, 2007 BIBLIOGRAPHIE